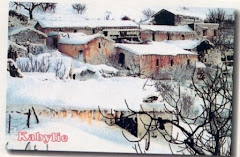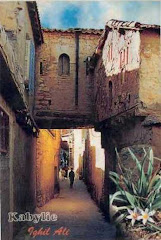Une pause. Il nous faut une pause et de suite. Les choses vont vite, si vite qu’à peine nous avons le temps de saisir toutes les mutations. Nous sommes dans la conséquence pure. Seul le moment présent et éphémère décide du cours de nos jours. Nous courrons dans tous les sens sans buts précis sinon ceux d’assouvir nos désirs primaires et d’accéder à des conforts égoïstes. Mais comme le dit le proverbe kabyle : « Il voulait voler comme la perdrix ; il a perdu la démarche de la poule. » Car à trop vivre le seul présent, à trop vénérer le désir, à trop courir derrière le confort égoïste nous voilà réduits à des individus sans âmes, à des déracinés sans repères et à un peuple qui végète sur les bas cotés de la civilisation en attendant sa disparition éminente. Le proverbe est bien approprié pour inaugurer « Les derniers Kabyles », premier roman de Rachid Oulebsir, paru le mois de juillet 2009 aux Editions Tira, en Algérie.
Enfant du pays avant tout, ancien enseignant et journaliste, Rachid Oulebsir nous propose ici une histoire réaliste fondée sur l’observation minutieuse et une critique lucide de la société kabyle d’aujourd’hui. Articulé autour de 12 parties et des sous-chapitres simplement numérotés à la manière kunderienne,
« Les derniers kabyles » est le récit d’un fonctionnaire kabyle qui a fait le choix de renoncer au
« confort » d’Alger, la capitale, pour revenir s’installer dans son village natal, Ighil, dans l’aârch des At Melikeche, une importante communauté de villages de Basse-Kabylie dont le chef-lieu est la commune de Tazmalt. Ce roman qui s’appui sur des éléments autobiographiques essentiels est remarquable à deux égards : D’abord par son écriture qui est d’une fluidité exemplaire ce qui renseigne sur l’esprit de son auteur et sa générosité, ensuite par son sujet :
« Les derniers kabyles » est un état des lieux de la Kabylie d’aujourd’hui. L’auteur n’aborde pas les problèmes politiques que connaît la région ni même ses revendications identitaires millénaires mais interroge les kabyles eux-mêmes, sur ce qu’ils étaient et ce qu’ils sont devenus dans leurs modes de vie. Je dirai même qu’ils leur demande des comptes ! N'est-ce pas juste de rendre des comptes quand on n’a pas su garder son héritage?
Le roman est écrit à la première personne du singulier mais le narrateur reste discret, presque à la marge. Ici, ce n’est pas le
« Je » qui nous renseigne sur la réalité de la Kabylie mais plutôt les personnages secondaires. A travers les trajectoires de chacun d’entre eux l’auteur parvient à cerner son terrain et à poser une problématique qui dépasse le cadre stricte de son histoire : Qu’est-ce que la modernité ? Est-ce qu’être moderne signifie avoir une grande maison, une voiture et de l’argent ? Est-ce qu’être moderne veut dire couper les ponts avec la tradition ? Est-ce qu’être moderne c’est vivre en ville ou à l’étranger d’où l’on réduit son village au simple vocable négatif de
« bled » et ses gens d’
« arriérés » ? Est-ce cela la modernité ? Car dans les villages qui constituent la Kabylie ne
« subsistent que les vieillards, des pièces de musées que la mort visite en irréductible kleptomane pour soustraire les uns après les autres les lots de valeur. Le musée fermera tôt ou tard. Restent des enfants auxquels des maitres moyenâgeux distillent la peur du jour, la haine du jeu, le refus de la vie, l’incertitude de l’avenir et l’inévitable châtiment divin.» (p.29) Nous serons des sans âmes ou tout au mieux des êtres anonymes. Et c’est ici que le titre trouve son sens.
« Les derniers kabyles » sont ceux et celles qui font vivre encore la Kabylie telle qu’elle a toujours était : besogneuse, chaleureuse, généreuse, joviale et foncièrement jalouse de ce qu’elle a et toute fière de ce qu’elle est. Et ces Kabyles là sont en voie de disparition. Après eux ne subsistera qu’un univers sans couleurs ni senteurs, un univers ou le vivre ensemble n’aura presque aucun sens. Des valeurs Kabyles: Amar-Touil, l’un des personnages du roman rappelle ce que être Kabyle :
« Le Kabyle qui ne réalise pas sa maison n’est pas un homme, dans nos valeurs. Edifier son logis, gagner le pain de ses enfants, protéger sa femme, mettre en valeur ses propriétés et participer à Tiwizi, l’effort collectif, voilà entre autre les fondements de la kabylité. Le Nif c’est tout ce qui rentre dans les relations avec autrui : payer ses dettes, racheter les terrains des ancêtres, défendre le village, honorer la région, sauver l’orphelin, et protéger la veuve ou l’handicapé. La Horma c’est ce qui touche à l’intérieur : combler sa femme, protéger ses filles par l’éducation, définir son territoire, sa maison, et préserver l’intimité, défendre les siens contre tout prédateur. Le fusil est le moyen de défense du Nif et de la Horma. » (p.68) Le roman prend toute sa profondeur à partir de là. L’univers kabyle et son imaginaire sensoriel est conté par l’auteur comme pourrait le faire une vielle de Kabyle du début du XXème siècle : avec tendresse et hardiesse.
Via ses personnages, Rachid Oulebsir nous rappelle qu’être Kabyle c’est avant tout se réaliser par la seule force de ses bras et de son intelligence. Ensuite, être kabyle c’est savoir vivre en communauté, savoir aider et donner comme on reçoit. Etre kabyle, enfin, c’est s’attacher à la terre, l’aimer et la travailler ce qui exige la sauvegarde de ses métiers et de ses savoir-faire. Car de tout temps c’est la terre qui a procuré aux Kabyles tant d’autonomie et pour laquelle ils ont toujours combattu. Avec une rare curiosité, l’auteur fait défiler devant nous tous les artisans des temps anciens qui ont été aux fondements de la cohésion sociale et de l’équilibre entre l’homme et la nature: dinandiers, potiers, chevriers, forgerons, bergers, bijoutiers, tisserandes…etc. C’était avant, bien avant que le développement durable ne devienne un thème politique et donc électoral ! Que reste-t-il de ces métiers et de cette façon d’être, aujourd’hui ? Aïcha Varzaq, un personnage féminin du roman et qui incarne toute la sagesse de son sexe répond :
« Tala (la fontaine) est silencieuse, le verbe s’assèche, la langue se perd, les murs craquent, les poutres sont vermoulus, la galette sent le brulé, le métier à tisser sont accrochés, les jarres des aïeux sont exposées sur les grandes routes, les abeilles refusent de butiner, les oiseaux ne chantent plus, les vaches ne vêlent plus, les filles vieillissent sans trouver de prétendants, les garçons ont peur de fonder leur foyer, la vie s’arrête ! Il nous reste Sidi-Lmoufaq –un Saint d’At Mlikeche- pour amortir notre descente aux enfers ! » (p.128) Plus loin L’Hacen-l’ancien, un autre personnage précise :
« Les salaires de l’Etat, les pensions et les mandats d’émigrés, ont crée d’autres valeurs sociales, d’autres étalons de mesure. Le travail, l’effort, la créativité ne sont plus des espaces de vitalité. C’est la consommation, le gain facile, les petits métiers, voir les conditions illicites qui sont devenues des terrains de concurrence, de rivalité. C’est à qui se vendra le mieux. Le Nif et la Horma sont à présent des thèmes de chansons pour Idhebbalen, les tambourinaires. » (p.186)La disparition des métiers: Le passage de l’ère agricole à l’ère industrielle s’est fait brutalement. Et pourtant aucun ne s’est posé la question de la nécessité même de ce passage. C’était dans l’ère du temps voilà tout. La mondialisation ou plutôt l’uniformité de la pensée et du mode de vie n’avait pas attendue l'ère de l'internet ! Au final, la culture populaire, les traditions et les savoir-faire ont été sacrifiés au profit de quelques routes, d’un salaire mensuel et de l’électricité. L’exode vers les villes à achevé le reste de la vie sociale et culturelle à l’ancienne. Ceci a été, d’ailleurs, parfaitement étudié par les sociologues Pierre Bourdieu (1930-2002) et Abdelmalek Sayad (1933-1998) juste après l’indépendance du pays et leur étude s’est soldée par
« Le déracinement », un excellent livre de sociologie rurale paru en 1964 aux Editions de Minuit.
En Kabylie aujourd’hui même l’architecture des maisons ne tient plus compte de l’impératif social. Il n’y a plus de limite entre l’espace d’habitation et l’espace d’activité. Les cités d’habitations construites par l’Etat ou les entrepreneurs achèvent ce qui reste de vie de communauté. Quant aux particuliers chacun improvise à sa manière. De nos jours la mode est de construire le long des routes existantes pour y ériger des garages à louer pour des tôliers, des mécaniciens, des gargotiers et autres dépanneurs. Le village en tant qu’espace de vie sociale tend vers la disparition. Tout est linéaire, en longueur et où l’espace de rencontre et d’échange n’est pas prévu. Le confort matériel individuel engendré par « la modernité » ont permis à chacun d’avoir une voiture et un salaire soit au pays soit à l’étranger. Le travail des champs et l’artisanat n’échoient qu’aux pauvres qui n’ont aucune alternative ! Hand Amazigh, un autre personnage du roman, illustre la décadence culturelle qui s’en suit :
« Quand l’arbre dessèche, les mots qui désignent ses racines, son tronc et ses branches meurent aussi. Quand un animal d’une espèce quelconque disparaît, son nom sera oublié, inévitablement. Le labour avec la pair de bœufs dressés est exprimé par un lexique très riche qui dépéri avec les derniers araires et les jougs de bois dur. » (p.197). Hand Amazigh a raison. Du temps de nos grands-parents même les discussions étaient illustrées de fables, de proverbes, de maximes pleines de sagesse et d’enseignement. Echanger avec un de nos anciens est un privilège dont nous nous rendons compte qu’après leur disparition. Voilà
« La Civilisation, ma Mère !... », pour reprendre le titre d’un roman célèbre de l’écrivain marocain Driss Chraïbi (1926-2007.)
Rachid Oulbsir insiste beaucoup dans son roman sur l’importance des métiers dans la cohésion sociale et dans la sauvegarde de la culture régionale. Observons ce dialogue entre des personnages du roman autour du pressoir d’olives traditionnel
:« -Les vieux moulins font partie de l’âme kabyle (…), dit Malek- L’idéalisation du vieux pressoir d’Aristée ne tient malheureusement pas devant les analyses de laboratoire (…), affirme Takfarinas-Les paysans n’ont cure des arguments techniques (…) les raisons ne sont pas que culturelles et sentimentales. Ils refusent que la machine sans âme les délestent de leur savoir-faire, assène le respectable Aïssa.-Le vieux moulin faisait travailler beaucoup de monde. En plus de l’équipe des de gaillards qui s’occupait du pressoir manuel, il faisait appel aux services du scourtinier qui tisse les sacs plats en fibres végétales, au tailleur de pierre qui refait le champs de la meule, au maitre huilier qui goutte et classe les huiles, au bucheron qui fournit le bois pour la chaudière, au savonnier qui emporte le grignon pour fabriquer du savon, aux simples ouvriers qui déchargent les olives et qui emplissent la piste de broyage ! explique Tahar-le-borgne (...)-Le vieux moulin avait un pouvoir structurant très important. Le maroquinier qui produit des vêtements et des tabliers de cuirs était sollicité. Le dinandier fournissait de son coté tous les ustensiles de conservation et de mesure, litre, décalitre, ensuivre ou en laiton. Toute une noria de métiers tourne autour du vieux moulin de pierre et de bois ! ajoute Amar-Touil » (p.268)La mort absurde des civilisations:Nous le voyons bien : l’homme était au centre de l’économie traditionnelle. Dans le cas du pressoir d’olive traditionnel au moins 10 métiers artisanaux étaient sollicités ! Mais la modernisation des outils de production a achevé tous ces métiers au profil d’une seule machine qui fait tout. Au-delà de la main d’œuvre réduite, la machine a éliminé le lien social comme fondement de la vie de société et en cela Rachid Oulebsir pose avec lucidité la question du sens que peut avoir aujourd’hui le travail dans nos sociétés. Car lorsque le travail est dépourvu de sa dimension sociale, il devient une corvée ou une forme d’esclavage.
En Kabylie, l’abandon des métiers a entrainé une dépendance accrue aux nouveaux modes de production et de consommation et ceci a remis en cause l’autonomie ancestrale qui a toujours caractérisée ses habitants. Cette dépendance a eue aussi pour effet
« la privatisation de l’individu » pour reprendre le philosophe grec Cornelius Castoriadis (1922-1997). C'est-à-dire que ce qui constitue le centre de la vie de nos jours est l’individu et sa petite famille et non pas la communauté au sens général. L’absence d’échange qui en découle entraine la pauvreté de communication, la disparition de la langue, des rites et des traditions qui font la spécificité de ce peuple. Rachid Oulebsir est, d’ailleurs, parti d’une question toute simple pour construire son histoire : qu’est-ce qu’être kabyle aujourd’hui ? Car,
«de nos jours, le Kabyle perd son identité sans en acquérir une nouvelle. Il se dépersonnalise, ce qui fait de lui un ballon shooté entre l’Orient et l’Occident», répond Tahar le borgne, un autre personnage du roman.
« La modernité » entendue comme confort individuel, mécanisation et uniformisation du mode de vie et de pensée a eu raison de ce peuple qui a su défier le temps. La négligence de ses membres en est une autre raison. Au chapitre 12 -le dernier- Rachid Oulebsir illustre la vie des Derniers kabyles par une image à haute charge symbolique : l’arrivée de l’électricité au village d’Ighil, ce qui symbolise
« la modernité » et la mort le jour même de la doyenne des villageois, tante Adada.
« Elle nous quitte alors qu’arrive l’électricité ! » remarque Amar-Touil (p.338).
« Heureuse Adada, elle ne vivra pas notre déclin, notre déchéance ! » affirme Aïcha. (p.341) C’est la modernité uniformisatrice qui met fin au monde des anciens !
La disparition des métiers, le peu de considération pour le Nif et la Horma, l’individualisation et la folklorisation de notre patrimoine ancestral ne sont pas pour autant des éléments d’une œuvre pessimiste. Ils sont les éléments d’une œuvre réaliste qui dissimule beaucoup d'espoir. A travers son regard juste et plein de générosité l’auteur invite les Kabyles à un moment de réflexion profond et, au-delà, c’est toute l’humanité qu’il interpelle sur l’importance des cultures, de la diversité et des couleurs humaines dans le monde. Le texte de Rachid Oulebsir me rappelle, ainsi, un autre texte de Mouloud Mammeri (1917-1989),
"La mort absurde des Aztèques" qui a inauguré son œuvre
"Le banquet" (1973), un texte dans lequel il adresse cette mise en garde à toute l'humanité:
« Les Aztèques c’était hier, nous vivons encore l’aventure qui les a vu combattre et disparaître. Leur histoire est la nôtre. Ils n’ont eu que le privilège fatal de venir les premiers et de s’offrir sans ruse et sans paravent aux coups d’un destin dont nous subissons encore les arrêts. Ils offrent la version nue d’une tragédie devenue planétaire : tous maintenant nous savons que nous sommes mortels, qu’il faut soutenir à bouts de bras l’univers, pour l’empêcher de sombrer dans les retombées délétères d’une fission d’atome qui n’est que l’image de la fission de notre raison (…) Désormais toute différence que nous effaçons –par quelque moyen que ce soit- est un crime absolu : rien ne la remplacera plus, et sa mort accroit les risques de mort pour les autres. » Oui, toute différence que nous effaçons rien ne la remplacera. Rien.
Hakim AMARA
P/S .Rachid Oulebsir a publié aussi en juillet 2008, aux Editions l'Harmattan, un essai intitulé "L'olivier en Kabylie, entre mythe et réalité"